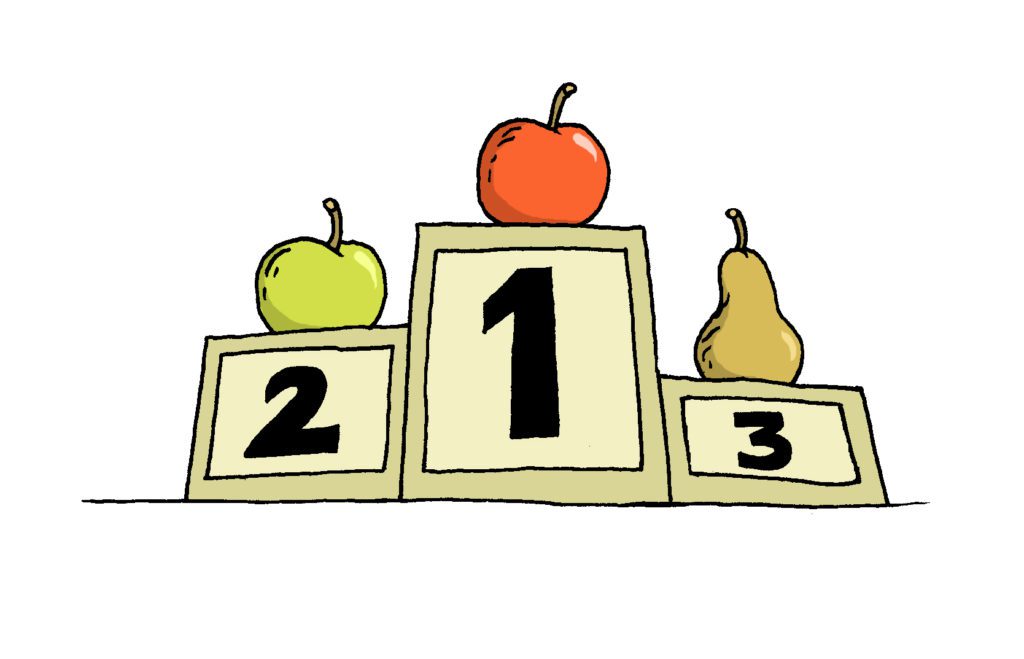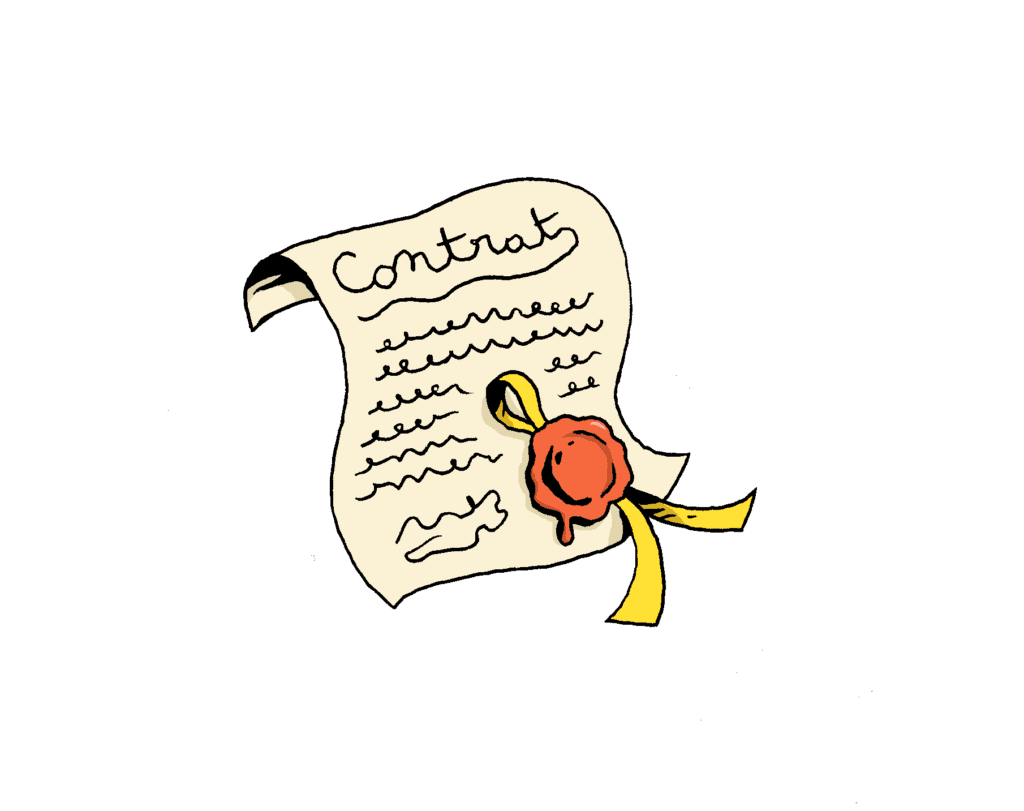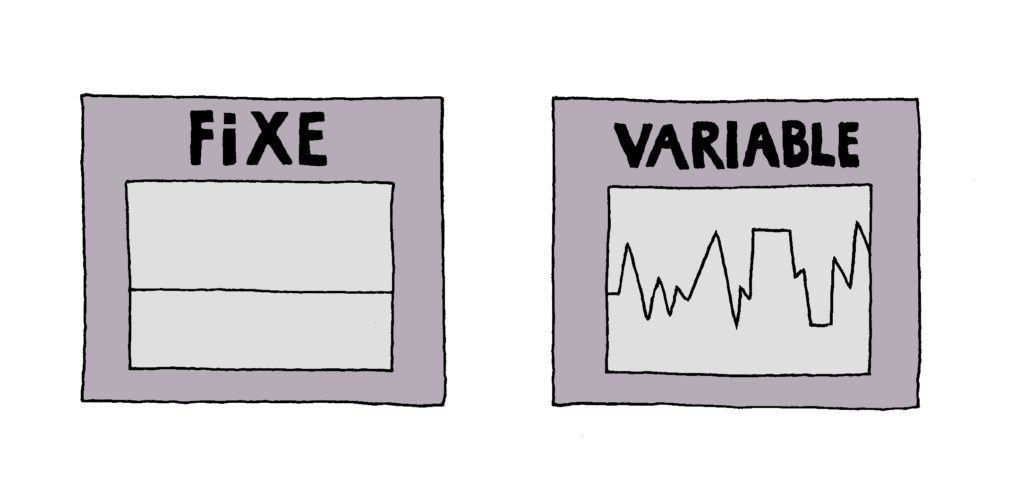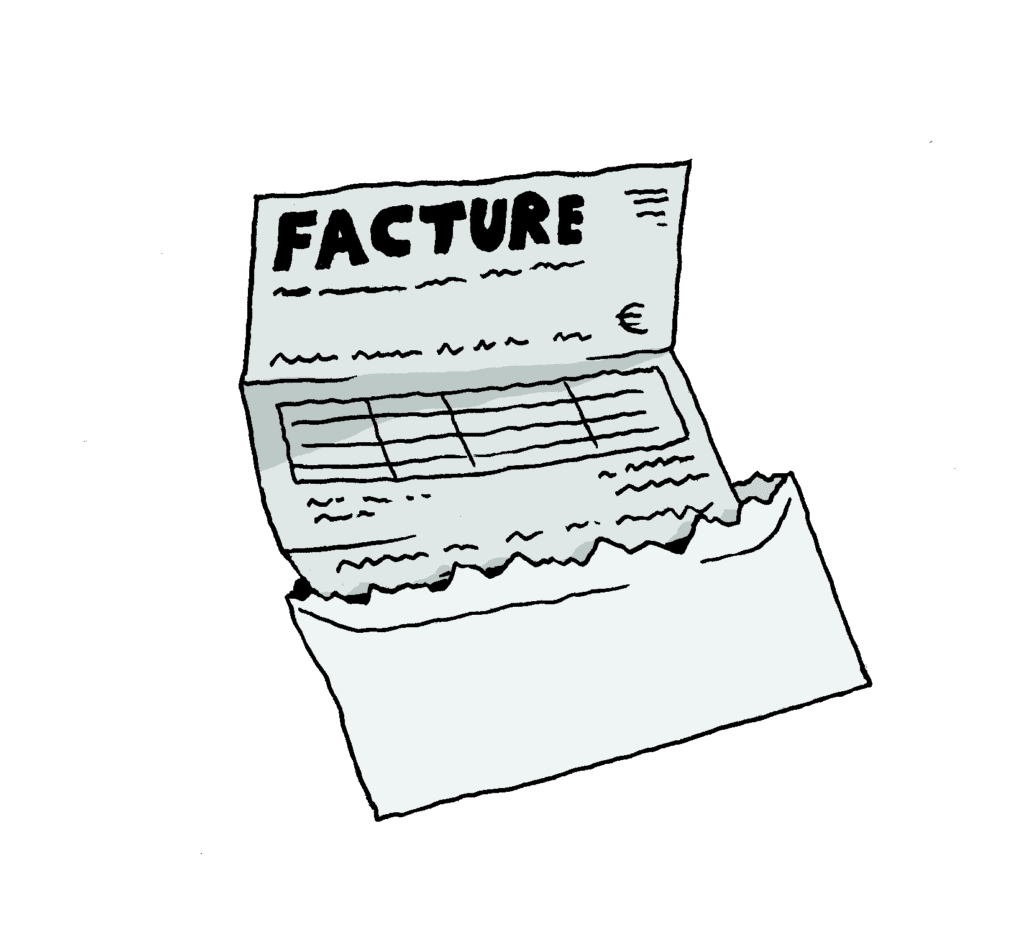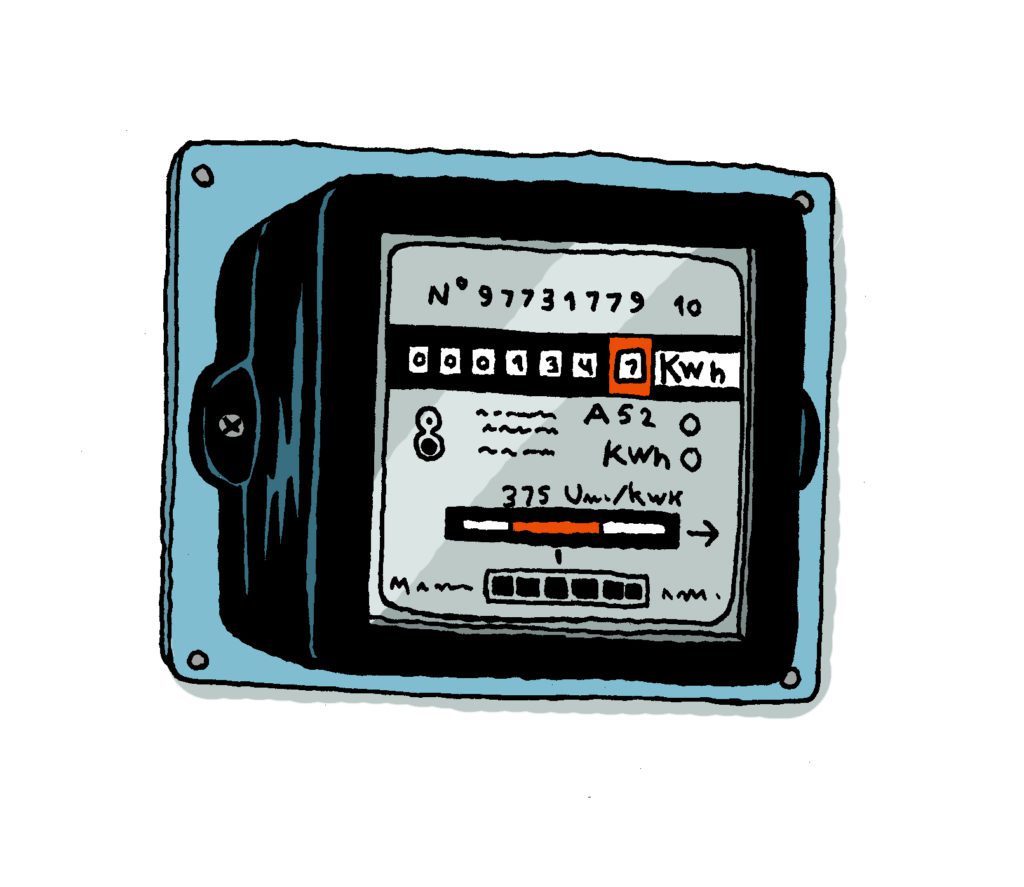Par Nicolas Per
1 Réformer le tarif social : quels enjeux pour les ménages vulnérables ?
La réforme du tarif social pour l’électricité et le gaz, envisagée en Belgique à la suite d’une proposition de résolution relative à la réforme du tarif social pour l’énergie déposée le 6 septembre 2024 (DOC 56 0195/001), soulève beaucoup de questions. La CREG, le régulateur de l’énergie, vient de publier un avis qui met en lumière les avantages et les inconvénients déjà identifiés que ce changement pourrait entraîner pour les ménages les plus fragiles.
Cet avis s’appuie sur des travaux antérieurs et alimente un débat essentiel : comment mieux protéger les consommateurs vulnérables ?
2 La proposition de résolution
La proposition de résolution déposée par Tine Gielis et Nathalie Muylle (cd&v) le 6 septembre 2024 avance plusieurs pistes de réforme du tarif social : l’introduction de conditions d’accès basées sur les revenus (alignées sur les plafonds de l’intervention majorée de l’INAMI), la prise en compte de la composition du ménage, l’application d’un système dégressif, ainsi que la transformation du tarif social en une prime modulable liée au contrat le moins cher du fournisseur. Elle invite également le gouvernement fédéral à renforcer les outils d’évaluation des revenus, à généraliser l’attribution automatique via une base de données fédérale en cours de développement et, dans l’attente, à recourir à un formulaire avec déclaration sur l’honneur.
3 Un système actuel protecteur et automatisé
Dans nos articles précédents[1], nous soulignions l’efficacité du tarif social tout en reconnaissant ses limites. Aujourd’hui, en s’appliquant directement sur les kWh consommés et donc sur la facture d’énergie, ce qui garantit que l’aide profite aussitôt à ce poste essentiel, il est imputé mensuellement sur les acomptes, puis sur la facture de décompte, sans décalage entre consommation et soutien financier. De ce fait, il s’applique de manière identique, quel que soit le fournisseur d’énergie ou la zone de distribution.
Autre avantage majeur : il est automatique pour plus de 90 % des ayants droit, limitant fortement le risque de « non-recours ». Le tarif social suit également l’évolution du marché tout en garantissant le prix le plus bas, avec un mécanisme de plafonnement qui protège contre les hausses extrêmes. En 2022, au plus fort de la crise énergétique, il est resté bien en dessous des prix commerciaux, évitant à de nombreux ménages des factures impayables. Le tarif social inclut un avantage supplémentaire : la composante « réseau » est calculée sur la base de la zone de distribution la moins chère, ce qui réduit encore la facture. Enfin, le tarif social actuel ne comporte pas de redevance fixe, quand certains contrats proposent des redevances fixes onéreuses.
Les études convergent pour souligner l’efficacité du tarif social durant la crise énergétique. La Banque Nationale de Belgique l’a qualifié de mesure essentielle pour soutenir les ménages en difficulté[2]. La Fondation Roi Baudouin, dans son baromètre de la précarité 2024, a mis en évidence sa capacité à protéger en priorité les foyers aux plus faibles revenus[3]. En 2022, ces derniers ont en effet été mieux protégés des effets de la crise grâce au tarif social, contrairement aux ménages appartenant aux deux déciles supérieurs de revenus. Une comparaison européenne menée par FORBEG[4] confirme d’ailleurs que le dispositif belge est le plus protecteur pour les consommateurs vulnérables, en maintenant leur facture énergétique à un niveau comparable à celui des ménages aux revenus moyens.
4 Comparaisons chiffrées
Les analyses de la CREG montrent que, sur la période 2019-2024, le tarif social a presque toujours été inférieur à l’offre commerciale la moins chère, tant en gaz qu’en électricité. L’écart s’est creusé en 2022, lorsque les prix ont explosé : pour une consommation moyenne, l’écart entre la facture annuelle au tarif social et l’offre commerciale moyenne était de 750 euros pour l’électricité et de 2071 euros pour le gaz, soit 2821 euros pour les deux énergies. Pendant la crise des prix, le tarif social a limité la hausse de la facture grâce à son mécanisme de plafonnement.
Du côté des coûts de réseau, les différences sont également notables : selon les calculs de Creg, en 2024, un ménage protégé vivant dans une des zones de distribution les plus chères a pu économiser jusqu’à 315 euros par an sur sa facture de gaz et 137 euros pour l’électricité grâce au tarif social. Une prime forfaitaire, identique, ne compenserait pas les écarts entre régions.
5 Les limites d’un système de primes
Dans son avis la CREG pointe plusieurs limites au système d’aide reposant sur une prime forfaitaire. Certes, celui-ci présente un avantage évident : la simplicité et la transparence. Chaque consommateur vulnérable reçoit la même somme, sur une base régulière (mensuelle, annuelle, etc.), ce qui facilite aussi les estimations budgétaires : il suffit de multiplier le nombre d’ayants droit par le montant de la prime. Cette formule a donc le mérite d’être lisible, prévisible et administrativement plus légère.
Cependant, ce modèle suscite plusieurs réserves par rapport au système actuel du tarif social. Tout d’abord, il ne tient pas compte de la consommation réelle : deux ménages recevront la même aide, même si l’un consomme très peu et l’autre beaucoup plus. En pratique, le soutien varie donc fortement selon les profils. La question de la consommation énergétique et des dépenses qu’elle engendre pour les ménages est étroitement liée à la qualité des logements qu’ils occupent, et leurs tailles. Le profil des ménages les plus pauvres se caractérise par une concentration dans des logements mal isolés et peu performants, ce qui entraîne une consommation plus élevée. À Bruxelles, ce constat est encore accentué par un parc de logements particulièrement vétuste[5]. Dans ce contexte, la transformation du tarif social en une prime forfaitaire risque d’accentuer les inégalités : tous les bénéficiaires recevraient le même montant, alors même que leurs besoins énergétiques varient beaucoup en fonction de la qualité de leur logement.
Par ailleurs, une prime forfaitaire ne s’adapte pas automatiquement aux fluctuations des marchés de l’énergie : calculée sur base de données historiques ou d’anticipations, elle risque d’être déconnectée des besoins réels des bénéficiaires au moment où les prix évoluent rapidement.
Un autre enjeu réside dans le lien entre la prime et les factures d’énergie. Si l’aide n’est pas directement rattachée à la consommation, elle peut se diluer dans le budget global du ménage et être utilisée à d’autres fins, ce qui affaiblit la logique de soutien ciblé face au coût de l’énergie. De plus, l’idée de rattacher la prime au prix de « l’offre la moins chère » pose des questions pratiques : comment identifier cette offre, l’actualiser régulièrement, tenir compte des abonnements ou remises, et surtout garantir l’accès aux consommateurs vulnérables souvent peu familier avec les démarches en ligne ?
Le risque majeur est que les primes ne bénéficient pas pleinement aux ménages vulnérables si ceux-ci restent liés à des contrats parmi les plus chers du marché. Plusieurs études du régulateur montrent en effet qu’une majorité de consommateurs souscrit à des produits coûteux, tandis qu’une minorité seulement profite des offres les plus avantageuses. Sans dispositifs d’accompagnement, le soutien financier risque donc de perdre en efficacité. Pour des ménages déjà précarisés, l’identification du contrat le moins cher apparaît d’autant plus complexe. En définitive, la simplicité du système de primes doit être mise en balance avec ses limites, qui interrogent sa capacité à protéger efficacement les ménages vulnérables par rapport au dispositif actuel.
En définitive, la simplicité apparente du système de primes doit être mise en balance avec ces écueils, qui interrogent sa capacité à protéger efficacement les ménages vulnérables par rapport au dispositif actuel des tarifs sociaux.
6 Quelle voie pour l’avenir ?
Dans son dernier avis, la CREG défend l’idée d’un élargissement du tarif social par l’instauration d’un critère de revenus en complément du critère de statut social. Beaucoup de ménages ne disposant pas d’un statut ouvrant le droit au tarif social n’échappent pour autant pas à la précarité. La proposition de la CREG prévoit en ce sens d’intégrer un critère calqué sur les plafonds de l’INAMI pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM), soit environ 27 500 euros par an pour une personne seule, majorés de 5 000 euros par personne supplémentaire. Ce changement permettrait d’éviter qu’à revenus quasi équivalents, un ménage bénéficie du tarif social tandis que l’autre en est exclu.
La CREG soutient aussi le système dégressif envisagé par la proposition de résolution de loi, proposant que son octroi soit fondé sur les revenus afin de mieux cibler l’aide et d’atténuer l’« effet de seuil » qui exclut aujourd’hui des ménages dépassant légèrement le plafond. Elle insiste sur la prise en compte de la composition familiale, pour éviter de pénaliser les familles monoparentales. Le dispositif envisagé consisterait à accorder un tarif dégressif aux ménages dont les revenus se situent juste au-dessus du plafond, avantage qui s’effacerait peu à peu lorsque les revenus atteignent 150 % de ce seuil. La CREG souligne que ce mécanisme
améliorerait le ciblage des aides tout en limitant le risque que des ménages aux revenus modestes, mais légèrement supérieurs au plafond, se retrouvent exclus.
Pour éviter une complexité excessive, le régulateur recommande de limiter ce système à deux catégories : un tarif social complet et un tarif réduit, éventuellement limité à la composante énergie. Chez Infor GazElec, nous défendons depuis longtemps l’instauration d’un tarif social dégressif, qui permettrait de réduire l’« effet de seuil » excluant certains ménages : ceux qui ne sont pas les plus précaires, mais restent en situation de vulnérabilité. Un tel mécanisme contribuerait à rétablir l’équité, en allégeant le poids de la facture d’énergie dans leur budget et en les protégeant contre les instabilités du marché.
Enfin, la CREG insiste sur l’importance de maintenir un système automatisé. Recourir à des formulaires ou à des déclarations porte en effet le risque d’exclure des bénéficiaires et de générer des coûts supplémentaires. La priorité devrait être donnée à la mise en place d’une base de données fédérale fiable.
En conclusion, la réforme du tarif social ne doit pas sacrifier son efficacité actuelle au nom de la simplification. L’objectif central devrait être de garantir que les ménages vulnérables soient protégés de manière efficace, équitable et durable contre les fluctuations du marché de l’énergie.
[1] Voir : https://www.inforgazelec.be/fr/reforme-tarif-social/
https://www.inforgazelec.be/fr/le-tarif-social-fonctionnement
https://www.inforgazelec.be/fr/tarif-social-de-lenergie-evolution-enjeux-et-perspectives-pour-les-menages-vulnerables/ https://www.inforgazelec.be/fr/evolution-du-tarif-social-2023-2024-2/
[2] Rapport 2022 de la Banque Nationale de Belgique « Préambule, Développements économiques et financiers, Réglementation et contrôles prudentiels », pp.102 et 103, https://www.nbb.be/fr/articles/rapport-2022-developpements-economiques-et-financiers
[3] Publié en 2024, le baromètre porte sur l’année 2022. Le document est disponible en ligne, à l’adresse : https://kbs-frb.be/fr/barometre-de-la-precarite-energetique-2024
[4] FORBEG, « A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers », mai 2023, p. 327.
[5] Pour approfondir voir l’article sur notre site : https://www.inforgazelec.be/fr/le-logement-a-bruxelles-etat-des-lieux/