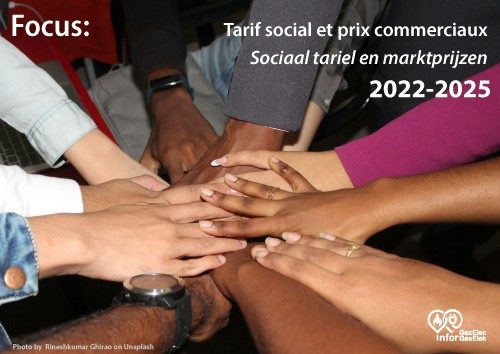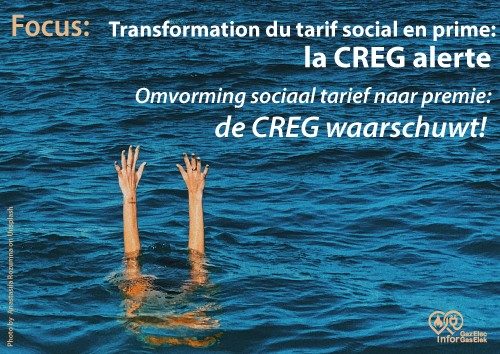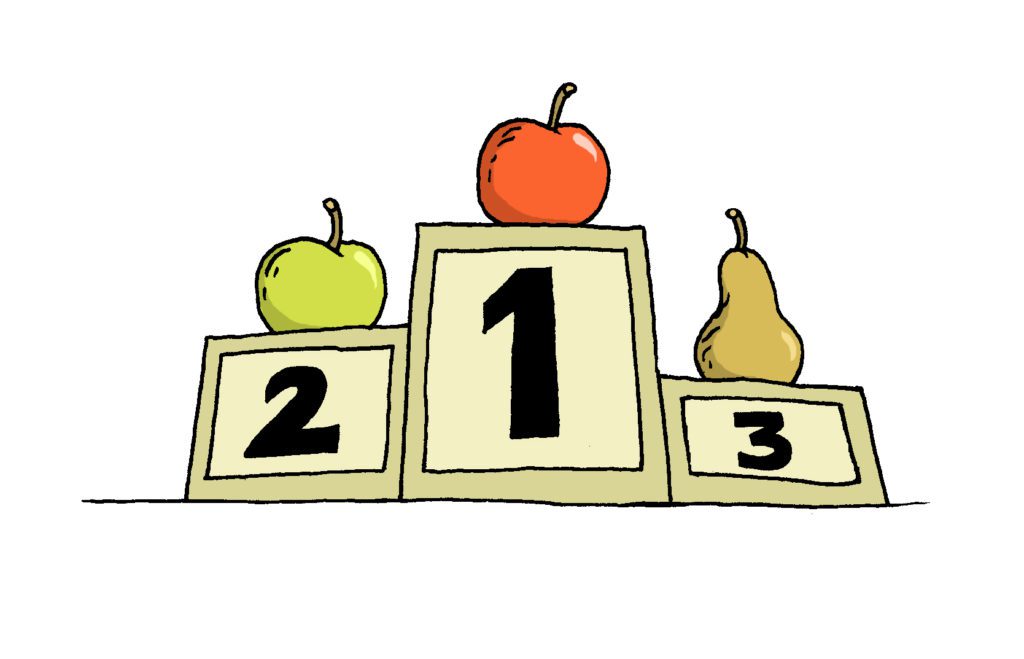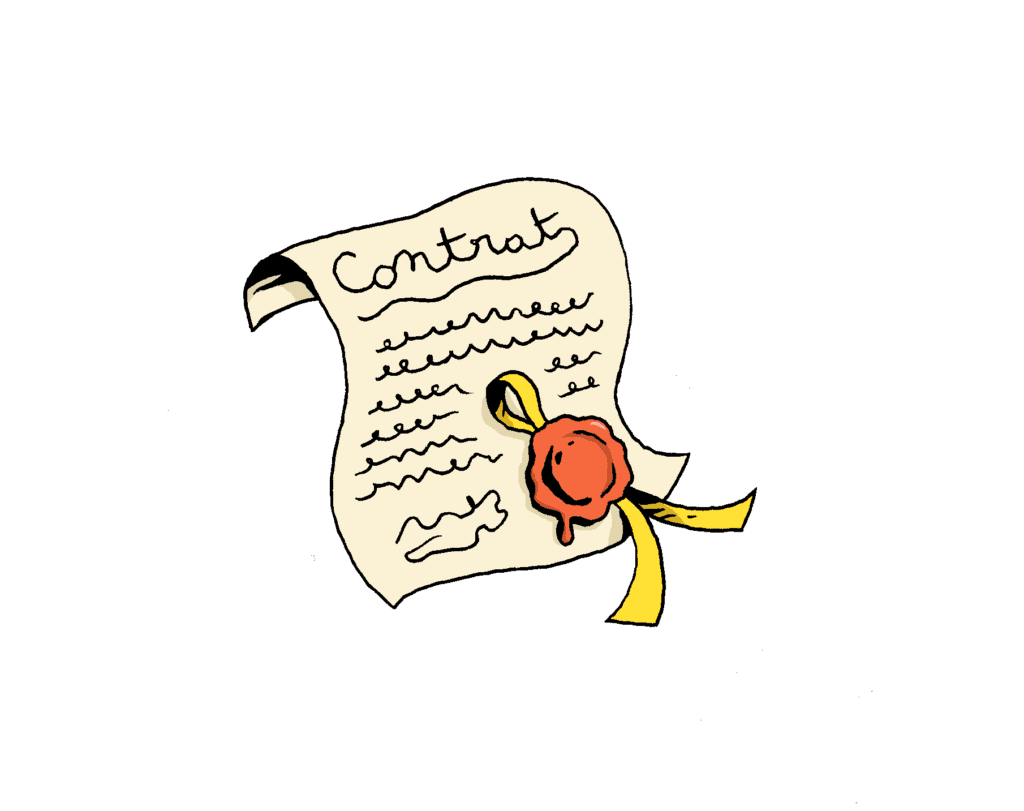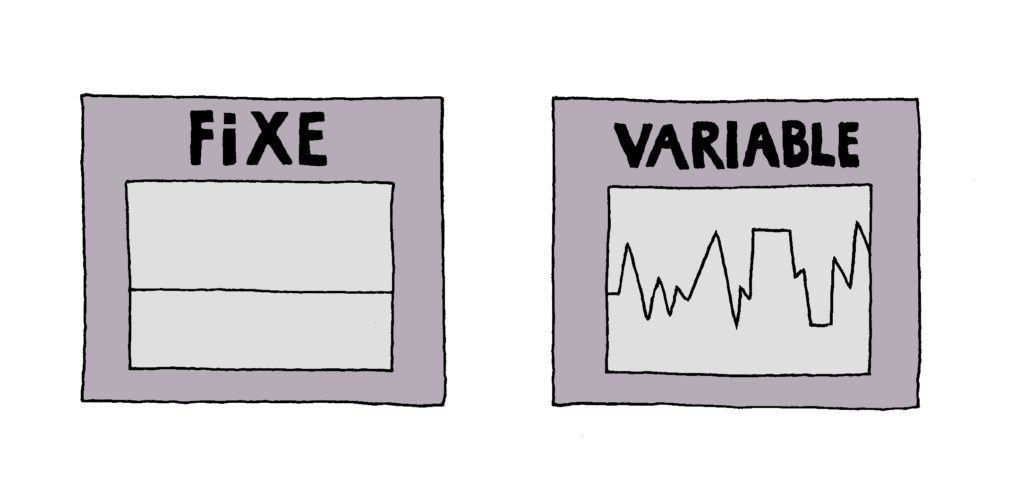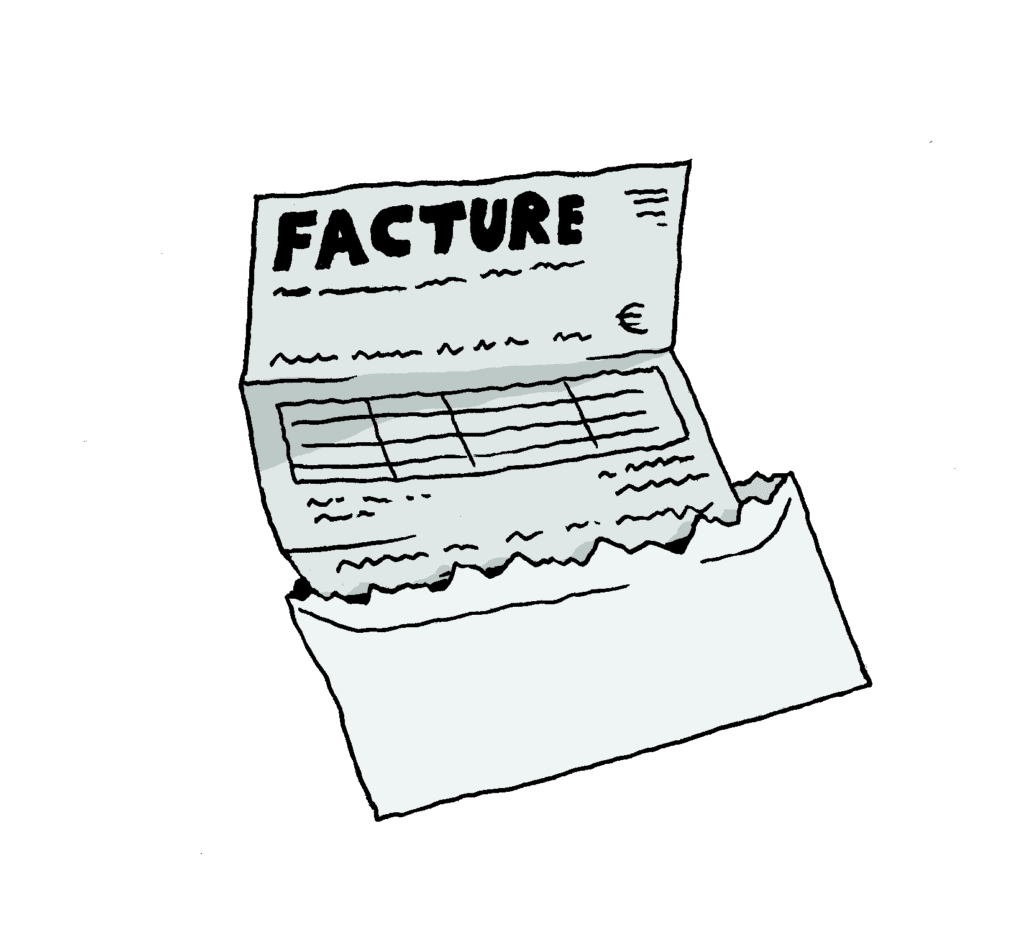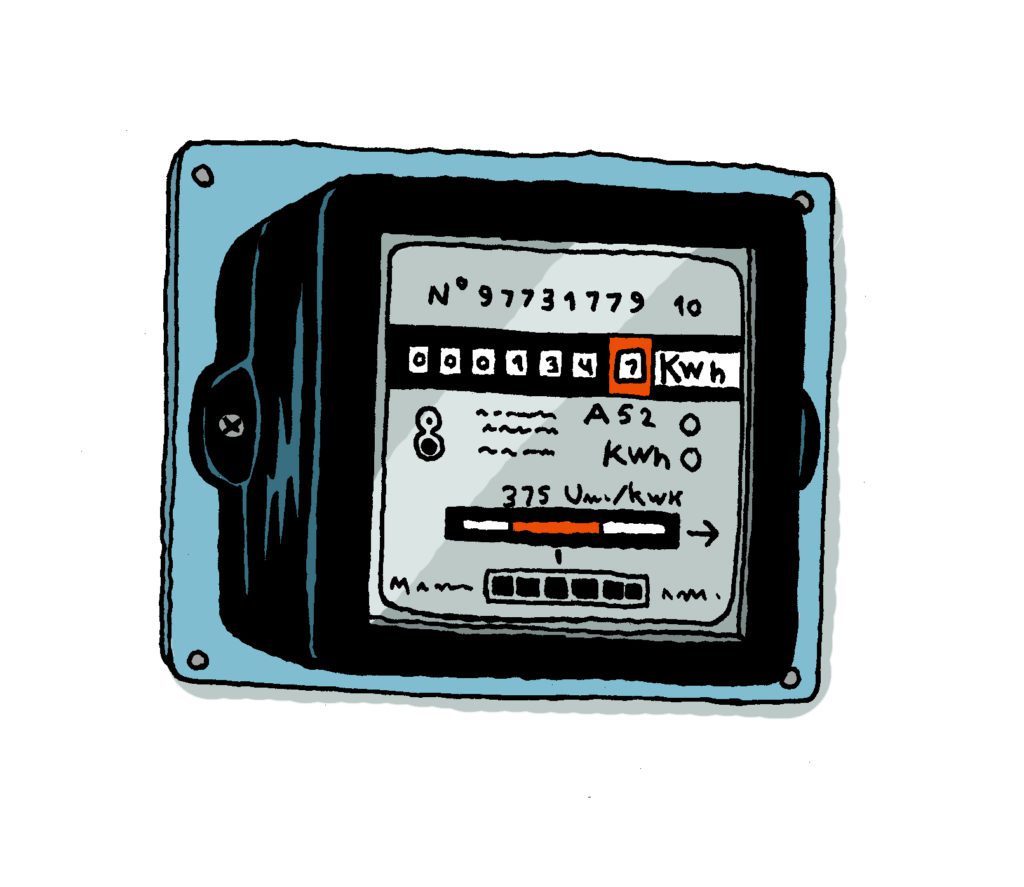Par Antoine Printz
La réforme des allocations de chômage, qui exclura des dizaines de milliers de Belges de leur droit aux indemnités, ne bouleverse pas seulement le revenu des ménages : elle modifie aussi leurs droits en matière d’accès à l’énergie.
« Limiter le chômage dans le temps, c’est une mesure de justice sociale », c’est ainsi que Georges-Louis Bouchez, président du MR, défend la réforme des allocations de chômage dans un billet sur le site du parti modestement intitulé « La bonne explication — Réforme du chômage ». Une réforme, portée par le ministre David Clarinval, réformateur lui aussi, désormais bien réelle : le projet de loi-programme concernant la réglementation du chômage a été adopté par la Chambre le 18 juillet 2025 et publié au Moniteur belge le 29 juillet. Mais la réalité est sans aucun doute plus inquiétante que la « bonne explication » selon le MR : 231 000 courriers auraient déjà été préparés par l’ONEM, présentés au comité de gestion de l’office le 15 juillet dernier, pour prévenir les personnes concernées de leur exclusion prochaine[1]. En janvier 2026, lors de la première vague d’application, plus de 50 000 personnes perdront leur droit aux allocations, et l’on estime qu’environ 20 000 d’entre elles se tourneront vers les CPAS pour obtenir le revenu d’intégration sociale.
Ce transfert massif est évidemment inquiétant pour le portefeuille de milliers de ménages et risque d’accroître l’appauvrissement d’une grande partie de la population. Il fragilise en outre le modèle de sécurité sociale et menace d’asphyxier des pouvoirs locaux déjà souvent exsangues[2]. Ces exclusions, et le basculement d’une partie des personnes concernées vers le revenu d’intégration sociale, auront aussi des conséquences en matière d’accès à l’énergie. C’est ce sur quoi nous nous penchons dans cet article.
1 Limitation des allocations de chômage
La réforme vise à restreindre le droit aux allocations de chômage à un maximum de 24 mois : une période de base de 12 mois, complétée éventuellement par 12 mois supplémentaires selon le passé professionnel. Présentée par le ministre Clarinval — dans un communiqué aux accents triomphants et satisfaits — comme une « réforme historique[3] », elle devrait exclure, à terme, au moins 180 000 personnes, dont plus de 40 000 en région bruxelloise. Dans certaines communes bruxelloises comme Saint-Josse, Molenbeek ou Saint-Gilles, la proportion d’exclus pourrait atteindre ou dépasser 4 % de la population communale[4].
La réforme s’appliquera progressivement, en six vagues jusqu’en juillet 2027, ce qui permet de répartir l’impact dans le temps, mais le nombre élevé de personnes concernées dès la première vague souligne l’ampleur du changement et ses possibles conséquences sociales et locales. La réforme se déploiera donc en plusieurs vagues, définies en fonction des publics concernés par l’exclusion du droit aux allocations de chômage:
- Vague 1 – 1er janvier 2026 : demandeurs en 3e période d’indemnisation avec au moins 20 ans de chômage complet au cours de la carrière et demandeurs bénéficiant d’allocations d’insertion ouvertes au plus tard le 1er janvier 2025.
- Vague 2 – 1er mars 2026 : demandeurs en 3e période, 8–20 ans de chômage.
- Vague 3 – 1er avril 2026 : demandeurs en 3e période, moins de 8 ans de chômage.
- Vague 4 – 1er juillet 2026 : demandeurs en 2e période.
- Vague 5 – 1er juillet 2026 à 1er juillet 2027 : demandeurs en 1re période, moins de 5 ans de passé professionnel.
- Vague 6 – 1er juillet 2027 : demandeurs en 1re période, plus de 5 ans de passé professionnel.
Au 1er janvier 2026, près de 55 000 Belges devraient perdre leur droit aux allocations de chômage. Que deviendront-ils ? Sur la base de l’expérience de 2012, lorsque la limitation des allocations d’insertion pour les jeunes avait conduit un tiers des exclus vers les CPAS et le revenu d’intégration sociale[5], on peut craindre une surcharge des services locaux. Luc Vandormael, président de la fédération des CPAS wallons, avait déjà évoqué un risque de « catastrophe pour les pouvoirs locaux ».
Au-delà de la dimension sociale et politique, cette situation a aussi des implications en matière de politiques énergétiques : l’appauvrissement des personnes combiné à la difficulté pour les CPAS de gérer la demande pourrait fragiliser l’accès à l’énergie et compliquer la mise en œuvre de mesures de soutien énergétique. Il convient dès lors de s’interroger sur l’accès à l’énergie, et aux dispositifs de sa protection, dans ce contexte de basculement de statut (et d’appauvrissement) de près d’un chômeur sur trois.
Outre le risque d’un basculement supplémentaire d’une partie de la population dans la privation énergétique — étroitement liée aux ressources financières disponibles —, on peut distinguer deux conséquences possibles pour les chômeurs exclus qui se tourneront vers les CPAS :
- L’accès automatique au tarif social grâce au statut de client protégé fédéral.
- L’obtention éventuelle du statut de client protégé régional à Bruxelles pour les personnes en situation de dette envers leur fournisseur commercial.
2 Le statut de client protégé fédéral
Les personnes se tournant vers le CPAS bénéficieront automatiquement du tarif social, leur statut de bénéficiaire du RIS leur ouvrant droit à cette mesure. Ce tarif s’applique en effet automatiquement à certaines catégories : bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou de certaines allocations liées au handicap. Ainsi, les quelque 20 000 nouveaux bénéficiaires du RIS attendus en janvier 2026 (et 60 000 en juillet 2027 selon les mêmes estimations) viendront s’ajouter aux quelque 500 000 clients protégés fédéraux existants[6].
C’est dans ce contexte que le Conseil des ministres a approuvé récemment un projet de loi présenté par la ministre de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt, et le ministre des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, Frank Vandenbroucke. Sur l’air d’une vieille rengaine libérale — celle des allocataires passifs, mieux lotis que ceux « qui luttent chaque jour pour trouver un emploi[7] » — il s’agira de limiter la possibilité d’un cumul des aides au sein d’un ménage. Comme c’était déjà annoncé dans l’accord de gouvernement : « Pour éviter les excès, nous plafonnons l’ensemble de l’aide et des prestations sociales », et d’enfoncer le clou trois lignes plus loin : « Nous prévoyons également un plafond sur le cumul des prestations sociales »[8].
Le même document prévoyait, dans le même temps, la réforme du tarif social par sa transformation en un « montant forfaitaire » qui tienne certes compte « du revenu et du statut », mais fasse attention d’« éviter tout effet secondaire lié à la distinction entre actifs/inactifs » (entendre, lutter contre ce fameux piège à l’inactivité que constituerait l’octroi d’un tarif régulé par rapport au tarif de marché). Qu’on se rassure donc : ce bénéfice secondaire (très faible, encore une fois) de l’exclusion du chômage et du basculement (éventuel) vers le RIS, lorsque la personne le demande, devrait être de courte durée, si le gouvernement mène à bien sa mission gestionnaire.
À court terme, on peut toutefois considérer qu’il s’agit d’un moindre mal pour les personnes exclues du chômage : elles paieront leur énergie un peu moins chère ! On notera cependant que l’obtention du tarif social, même automatique, se fait sur base trimestrielle. Ainsi, des personnes exclues en janvier ne pourraient voir leur tarif social appliqué qu’en avril ou mai, compte tenu du temps nécessaire au traitement des dossiers. Même si le calcul est rétroactif, il faut prendre en compte l’impact sur un budget déjà grevé d’acomptes trop élevés pendant quatre à cinq mois. Dans ce contexte, il serait judicieux que les CPAS fournissent rapidement les attestations de tarif social à leurs nouveaux bénéficiaires, afin de faciliter la communication avec les fournisseurs et de négocier des acomptes réduits, calculés sur le tarif social plutôt que sur le tarif commercial.
3 Bruxelles : client protégé automatique en cas de dette
À Bruxelles, comme on l’a vu, près de 40 000 personnes devraient être exclues à terme, ce qui correspond à l’entrée de quelque 15 000 d’entre elles dans les CPAS (en s’en tenant à l’estimation du tiers des exclus). Ici se pose une particularité bruxelloise, liée au statut de client protégé régional.
Ce statut prévoit que, en cas de dettes et sous certaines conditions, le ménage bascule temporairement vers une fourniture par Sibelga, le temps d’honorer son plan de paiement auprès du fournisseur commercial. Pour protéger les ménages les plus vulnérables, le législateur bruxellois a en effet introduit le statut de « client protégé » dans les ordonnances relatives à l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. Il s’adresse aux clients résidentiels en situation d’impayé vis-à-vis de leur fournisseur commercial. Pendant la durée de la protection, le ménage est alimenté par Sibelga, « fournisseur de dernier ressort », à un tarif plus avantageux. Ce statut constitue une mesure centrale pour la protection des usagers et usagères d’énergie, limitant souvent la précarité et, dans de nombreux cas, évitant la coupure. Il permet de bénéficier d’un tarif de fourniture social inférieur au tarif commercial, appelé le tarif social régional.
Dans les Ordonnances, il est prévu que Sibelga octroie automatiquement le statut de client protégé aux ménages bénéficiant du tarif social fédéral et ayant reçu une mise en demeure pour une dette de 150 € pour une énergie ou 250 € pour les deux. De ce fait, les nouveaux bénéficiaires du RIS pourraient être directement basculés vers une fourniture par Sibelga, pour une ou les deux énergies, dans le cas d’une telle dette.
Sans information claire et bien ciblée, on peut légitimement craindre que ces ménages éprouvent des difficultés face au changement non annoncé d’instance de facturation — du fournisseur commercial vers le gestionnaire de réseau — ou encore à une éventuelle double facturation, dans le cas où le statut de client protégé ne concernerait qu’une des deux énergies. Cette incompréhension pourrait avoir des conséquences concrètes : des factures impayées auprès de Sibelga, si les nouvelles factures ne sont pas honorées, tout en maintenant des dettes envers le fournisseur commercial. Le risque de confusion est donc réel et ne doit pas être sous-estimé.
Ce d’autant plus que la situation des CPAS, confrontés à une surcharge de travail, ne permettra peut-être pas un accompagnement en cette matière, complexe et très spécifique par rapport à ce qui constitue l’activité habituelle des agents, ce qui peut limiter leur capacité à anticiper et résoudre les difficultés rencontrées. À cela s’ajoute un facteur organisationnel : certaines cellules énergie seront temporairement mises en standby afin de mobiliser du personnel pour faire face à l’arrivée massive de nouveaux allocataires.
4 Protections énergétiques et statut social
Au total, ce cumul de facteurs — complexité administrative, manque d’accompagnement ciblé, formation insuffisante des agents et réorganisations internes des services — crée un environnement dans lequel les ménages les plus vulnérables risquent non seulement de se retrouver en difficulté financière, mais aussi de ne pas bénéficier pleinement des protections auxquelles ils ont droit. La nécessité d’une communication claire, précise et adaptée à ces publics apparaît ainsi comme une condition indispensable pour limiter les risques d’endettement et de malentendus.
Le fait que les personnes voient leur accès à l’énergie un peu mieux garanti une fois qu’elles émargeront au CPAS (dans l’hypothèse où elles s’y dirigent) reste un moindre mal qui ne saurait suffire à nous satisfaire pleinement. Certes, l’énergie coûtera un peu moins cher pour ces ménages lorsqu’elles bénéficieront du tarif social, mais on peut craindre d’une part que le train des réformes droitières ne s’arrête pas en si bon chemin, et que ces protections, faibles et limitées, ne puissent être considérées comme acquises.
Si l’on peut se réjouir de ce que les ménages soient ainsi protégés par des systèmes garantissant un accès à une énergie moins chère et prévenant le risque de coupure, il faut toutefois tenir compte du risque de manque d’information et de communication à destination des bénéficiaires. Il faut aussi considérer le poids budgétaire que représenterait, au niveau régional — qui ne dispose pas de prérogatives fiscales —, l’arrivée d’un grand nombre de ménages sous ce statut, qui, bien qu’essentiel pour les ménages pauvres, reste coûteux.
Ces enjeux annexes à la réforme du chômage sont cruciaux. Il s’agit évidemment d’en tenir compte, d’informer les agents chargés d’accompagner les chômeurs exclus et d’intégrer ces dimensions de manière globale dans la lutte contre les mesures extrêmement délétères de ce gouvernement.
[1] Corentin di Prima, « 231 000 chômeurs menacés d’exclusion », L’Écho, 29 août 2025
[2] Voir à ce sujet : Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens, « Chasse aux chômeurs : “Un retournement de la norme établie lors de la création de la Sécu” », Ensemble !, n° 114, novembre 2024.
[3] « Vote historique au Parlement : le projet de loi du ministre Clarinval limitant la durée du chômage est adopté ! », 18/07/25, disponible en ligne : https://www.mr.be/vote-historique-au-parlement-le-projet-de-loi-du-ministre-clarinval-limitant-la-duree-du-chomage-est-adopte/
[4] Selon les estimations de la FGTB : https://fgtb-wallonne.be/wp-content/uploads/2025/06/Annexe-Tableau-regions-et-communes-pop-exclue-et-indicateur-de-richesse.pdf
[5] Selon Bruno Van der Linden, professeur en économie à l’IRES-UCLOUVAIN : https://www.rtbf.be/article/1-chomeur-sur-3-bientot-exclu-5-consequences-previsibles-de-la-reforme-du-chomage-11528556
[6] CREG, Tableau de bord — août 2025, disponible en ligne : https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord
[7] https://www.rtbf.be/article/les-revenus-des-parents-ou-des-enfants-majeurs-vont-etre-pris-en-compte-dans-le-calcul-des-aides-sociales-11577808
[8] Accord de gouvernement